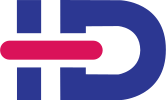Peut-on représenter l’invisible ? Qu’est-ce qu’une statue de culte ? Un dieu peut-il en dissimuler un autre ? Comment s’articulent rite et image ?
Fruit d’une recherche collective menée par des doctorants et jeunes chercheurs, dans le cadre de séminaires organisés à l’École française de Rome, à l’École française d’Athènes et à l’Université Paris-X Nanterre sous l’égide de l’UMR ArScAn du CNRS, ce colloque propose une réflexion approfondie sur le rôle de l’image dans la construction et la perception du sacré dans les polythéismes antiques.
Des figures de Tartessos aux stèles d’Anatolie, des divinités à demi-voilées de Cyrène à la plastique géométrique ou aux mosaïques tardives de l’Antiquité gréco-romaine, cette enquête sur les relations entre « Image » et « Religion » embrasse l’ensemble du bassin méditerranéen.
Réparties en cinq chapitres, les trente-neuf contributions explorent à la fois le contenu et les formes des représentations, ainsi que leurs contextes d’utilisation. Elles analysent les tensions entre les limites de la représentation visuelle du divin et les risques de banalisation liés à la prolifération des images dans des contextes domestiques. Ces études abordent notamment les modalités de consécration des statues, les interactions entre l’image, l’imaginaire religieux et le rituel, ainsi que les formes d’expression identitaire véhiculées par les représentations divines.